« Révolution culturelle » par Jean-Pierre Digard
Sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, Jean-Pierre Digard a fait une intervention remarquée-et remarquable-dans le cadre de la table ronde intitulée?« sociologie des éleveurs et des utilisateurs de chevaux ».Nous publions ici, avec
son aimable assentiment, la première partie de sa réflexion. La suite sera publiée dans notre prochaine édition du 19 janvier 2009.?A Consommer sans modération.
Le cheval dans la tourmente des mutations sociales et culturelles du XXIe siècle
On ne devrait pas avoir à rappeler cette vérité première : le cheval est un animal domestique; en tant que tel, il n’a d’existence que par les hommes qui le produisent et qui l’utilisent; sa place et son statut dépendent des évolutions de la société. Pour des raisons compréhensibles, les professionnels de la filière se sont davantage intéressés aux recherches sur le cheval, son alimentation, sa reproduction, ses maladies, qu’à celles sur son environnement social et culturel. Aujourd’hui, des évolutions se sont produites, sont en train de se produire, qui entraînent, dans le monde du cheval, une sorte de « révolution culturelle ». La FNC a le mérite incomparable d’avoir compris qu’il est nécessaire de s’intéresser aussi à ces évolutions sociales et culturelles. Telle est la raison de ma présence parmi vous aujourd’hui.
Je me propose donc de décrire ces évolutions, de préciser l’influence qu’elles exercent sur vos activités et d’examiner quelles attitudes ?il convient d’adopter face à ces changements.
I. Le nouveau paysage animalier français
L’observation de la société occidentale permet de repérer trois types principaux de rapports aux animaux, qu’il convient de distinguer soigneusement :
1 - des relations effectives, réelles d’élevage et d’utilisation d’« animaux de rente » (à finalité économique), relations qui sont généralement le fait de professionnels;
2 - des relations réelles, à dominante affective, avec des « animaux de compagnie », relations qui sont le plus souvent le fait d’amateurs;
3 - des relations fictives, imaginées et conçues comme un idéal à atteindre par divers mouvements militant pour la « cause animale », que je qualifierai ici d’animalitaires (par analogie avec humanitaire).
Quelles sont les changements qui ont affecté ces trois types de rapports et qui pourraient justifier que l’on parle aujourd’hui de « nouveaux rapports » aux animaux ?
1. Les transformations de l’élevage
Dans un contexte dominé par la nécessité de reconstruire l’économie détruite par la guerre de 39-45, l’élevage traditionnel, familial et polyvalent des années 1950, s’est concentré (les éleveurs représentent aujourd’hui moins de 1% de la population française), intensifié, industrialisé (le nombre des élevages hors-sol est en progression constante) et spécialisé (suscitant la formation de « filières » distinctes). Les changements intervenus par ailleurs dans la démographie et le mode de vie des Français n’ont fait qu’amplifier cette évolution : la population française est passée de ?40 millions après la guerre à près de ?70 millions aujourd’hui, et a « modernisé » ses habitudes de consommation ce qui a entraîné, notamment, un doublement de la consommation totale de viande en France entre 1950 et 2006 (malgré une stagnation de la consommation à 80 kg/personne/an depuis 1997).
Cette transformation a affecté les rapports hommes-animaux, qui sont devenus moins individuels, au point, parfois, d’entraîner du stress, tant chez les personnels que chez les animaux, soumis les uns comme les autres à une forte pression productiviste.
2. La croissance et l’évolution du phénomène « animaux de compagnie »
Le nombre de ces animaux a augmenté ?(en France, ils sont aujourd’hui plus de ?50 millions dont 9 millions de chats et 8 millions de chiens) comme a augmenté le nombre des foyers qui en possèdent (53 %). Ce qui a changé aussi, c’est le statut culturel des animaux de compagnie : ils font partie de la famille et même du « kit du bonheur parfait » de la famille moyenne, avec la maison individuelle et le jardin; rien n’est trop beau ni trop cher pour eux (dans le budget moyen des ménages, la part des animaux de compagnie est égale à la part des transports en commun, avion et bateau compris); ils sont de plus en plus anthropomorphisés, c’est-à-dire perçus et traités comme des humains, parfois même comme des substituts d’enfant ou de conjoint.
Le modèle dominant de l’animal de compagnie tend en outre à englober d’autres animaux, en particulier le cheval (j’y reviendrai dans un instant) et même la faune sauvage, sur laquelle se multiplient les documentaires animaliers montrant loups, ours, grands félins ou requins sous le traits de paisibles et inoffensives créatures, que l’homme, diabolisé, ne cesserait de persécuter sans raison...
3. La montée en visibilité de la mouvance animalitaire
Le monde de la protection animale est une nébuleuse complexe, qui comprend quelque 300 associations, qui vont de la SPA, fondée au milieu du XIXe siècle, aux « Amis du tourteau ».
Le changement tient, ici, à trois phénomènes conjoints :
1 - Un glissement progressif s’est opéré de la notion de « protection animale » conçue comme un devoir de l’homme, à la notion de ?« droits de l’animal » et même, pour les militants les plus radicaux, de libération animale au nom de l’« antispécisme » (mot calqué sur celui d’antiracisme pour les humains, par une analogie absurde puisque les espèces animales existent alors que les races humaines n’existent pas).
2 - La cause animalitaire est activement défendue auprès des autorités nationales et internationales par un lobbying à l’anglo-saxonne extrêmement puissant, ainsi, sur le terrain, que par des groupuscules radicaux hyperactifs, parfois très violents, au point d’être classés, aux États-Unis, comme la deuxième menace terroriste après l’activisme islamiste.
3 - Les idées protectionnistes rencontrent d’autant moins de résistance qu’elles se développent au sein d’une population majoritairement urbaine, coupée de ses racines rurales depuis plusieurs générations et qui n’a donc plus la moindre idée de ce que sont l’élevage et les animaux. Faute de résistance à qui viendrait l’idée de militer pour les mauvais traitements aux animaux ?, l’idéologie animalitaire s’est peu à peu érigée en une sorte de « politiquement correct », non d’ailleurs sans contradictions entre une opinion publique plutôt bienveillante envers les animaux et le comportement des consommateurs qui ne se montrent nullement prêts à payer plus cher des produits d’animaux élevés autrement. L’astuce stratégique du lobby animalitaire consiste donc à s’auto-proclamer porte-parole d’une majorité silencieuse... qui ne dément pas puisqu’elle est silencieuse et qu’au fond, rien de tout cela n’entre dans ses préoccupations prioritaires que sont le pouvoir d’achat, l’emploi, le logement et la santé.
Il n’existe d’ailleurs et j’insiste sur ce point aucune preuve de l’existence d’une « demande sociale » d’amélioration du sort des animaux d’élevage; cette prétendue « demande sociale » animalitaire n’est qu’une fiction, entièrement construite par les mouvements protectionnistes eux-mêmes, à partir de bribes d’opinions, souvent contradictoires, glanées ici et là, sélectionnées selon des critères philosophiques et éthiques par définition , et qui relèvent de la croyance et de l’émotion beaucoup plus que du raisonnement rationnel.
La préoccupation du « bien-être animal » (traduction controversée de l’anglais welfare), dont on nous rebat les oreilles et dans laquelle il faudrait voir la saine expression d’un?« juste milieu », n’est elle-même issue d’aucune « demande sociale », mais résulte :
1 - de la pression exercée, au niveau de l’Union européenne, par les lobbies anglo-saxons, dans le cadre d’une guerre commerciale entre agricultures du Nord et agricultures du Sud, pour affaiblir ces dernières en leur imposant des normes plus contraignantes de traitement des animaux aussi bien que sanitaires (pasteurisation des produits laitiers) ou linguistiques (hégémonie de l’anglais);
2 - de la reprise à leur compte de la notion de bien-être animal par les directions d’institutions scientifiques comme l’INRA dans un but de « communication », pour contrecarrer les accusations de productivisme contre-nature qui sont portées contre elles (voir Jean-Paul Bourdon, « Recherche agronomique et bien-être des animaux d’élevage. Histoire d’une ?demande sociale », Histoire et Sociétés Rurales, n° 19, 2003, p. 221-239).
Or le concept de bien-être animal est gravement entaché d’anthropomorphisme (certains militants parlent même du « bonheur » des animaux), il échappe à toute définition scientifique et est donc instrumentalisable à des fins militantes. Si ce « bien-être » correspond à un bon état de santé des animaux, la notion n’est pas nouvelle : les éleveurs parlent depuis déjà fort longtemps d’animaux « en état » et aucun d’eux (à l’exception de quelques brebis galeuses comme il y en a partout, ou de professionnels en très grande détresse) ne serait assez stupide pour mettre sur le marché des animaux pas en « état » qu’il risquerait de mal ou de ne pas pouvoir vendre ! Si c’est plus ou autre chose, qu’est-ce que c’est ? Comment pourrait-on savoir en quoi consiste le ?« bien-être animal » alors que les spécialistes de la santé humaine eux-mêmes ont renoncé à savoir ce qu’est le bien-être humain et qu’eux-mêmes ne parlent jamais que de ?« bien-traitance » (des enfants, des vieillards, des malades dans les structures d’accueil correspondantes) ? Cette notion de bien-traitance, qui fait référence à l’action exercée, est en effet infiniment préférable à celle de bien-être, qui se rapporte aux effets, difficiles à appréhender, présumés produits par cette action. Dans ce contexte d’incertitude, ?il faut une bonne dose d’inconscience voire de cynisme pour oser rechercher, par exemple en vue de labels de qualité viande, des critères de « bien-être » du bétail européen (critères de satiété, de temps de sommeil, etc.) qui sont inconnus d’une grande partie de l’humanité...
En réalité, l’injonction du bien-être animal dissimule un piège : sous des apparences de modération, de « juste milieu » se cache une redoutable logique de toujours plus, source d’une inévitable dérive extrémiste et anti-humaniste, qui pousse la revendication de « bien-être animal » à se muer (comme on le vit aux Rencontres « Animal et Société » du printemps 2008) en exigence de reconnaissance par le Code civil d’un statut particulier d’« être sensible » intermédiaire entre les personnes et les biens (avec les conséquences juridiques et économiques que l’on imagine), puis en revendication de « droits de l’animal » (voir la ?« Déclaration universelle des droits de l’animal » de 1978, obscène parodie de la Déclaration des droits de l’homme). La même dérive entraîne les végétariens (opposés à la consommation de viande) à devenir végétaliens (opposés à la consommation de tout produit animal) puis véganiens (opposés à toute utilisation et élevage d’animaux). Elle conduit, enfin, l’antispécisme à mettre en accusation et à diaboliser l’homme, et à se transformer ainsi en anti-humanisme, en?« spécisme » anti-humain...
Prochain article « La place particulière du cheval dans ce paysage général »
Le cheval dans la tourmente des mutations sociales et culturelles du XXIe siècle
On ne devrait pas avoir à rappeler cette vérité première : le cheval est un animal domestique; en tant que tel, il n’a d’existence que par les hommes qui le produisent et qui l’utilisent; sa place et son statut dépendent des évolutions de la société. Pour des raisons compréhensibles, les professionnels de la filière se sont davantage intéressés aux recherches sur le cheval, son alimentation, sa reproduction, ses maladies, qu’à celles sur son environnement social et culturel. Aujourd’hui, des évolutions se sont produites, sont en train de se produire, qui entraînent, dans le monde du cheval, une sorte de « révolution culturelle ». La FNC a le mérite incomparable d’avoir compris qu’il est nécessaire de s’intéresser aussi à ces évolutions sociales et culturelles. Telle est la raison de ma présence parmi vous aujourd’hui.
Je me propose donc de décrire ces évolutions, de préciser l’influence qu’elles exercent sur vos activités et d’examiner quelles attitudes ?il convient d’adopter face à ces changements.
I. Le nouveau paysage animalier français
L’observation de la société occidentale permet de repérer trois types principaux de rapports aux animaux, qu’il convient de distinguer soigneusement :
1 - des relations effectives, réelles d’élevage et d’utilisation d’« animaux de rente » (à finalité économique), relations qui sont généralement le fait de professionnels;
2 - des relations réelles, à dominante affective, avec des « animaux de compagnie », relations qui sont le plus souvent le fait d’amateurs;
3 - des relations fictives, imaginées et conçues comme un idéal à atteindre par divers mouvements militant pour la « cause animale », que je qualifierai ici d’animalitaires (par analogie avec humanitaire).
Quelles sont les changements qui ont affecté ces trois types de rapports et qui pourraient justifier que l’on parle aujourd’hui de « nouveaux rapports » aux animaux ?
1. Les transformations de l’élevage
Dans un contexte dominé par la nécessité de reconstruire l’économie détruite par la guerre de 39-45, l’élevage traditionnel, familial et polyvalent des années 1950, s’est concentré (les éleveurs représentent aujourd’hui moins de 1% de la population française), intensifié, industrialisé (le nombre des élevages hors-sol est en progression constante) et spécialisé (suscitant la formation de « filières » distinctes). Les changements intervenus par ailleurs dans la démographie et le mode de vie des Français n’ont fait qu’amplifier cette évolution : la population française est passée de ?40 millions après la guerre à près de ?70 millions aujourd’hui, et a « modernisé » ses habitudes de consommation ce qui a entraîné, notamment, un doublement de la consommation totale de viande en France entre 1950 et 2006 (malgré une stagnation de la consommation à 80 kg/personne/an depuis 1997).
Cette transformation a affecté les rapports hommes-animaux, qui sont devenus moins individuels, au point, parfois, d’entraîner du stress, tant chez les personnels que chez les animaux, soumis les uns comme les autres à une forte pression productiviste.
2. La croissance et l’évolution du phénomène « animaux de compagnie »
Le nombre de ces animaux a augmenté ?(en France, ils sont aujourd’hui plus de ?50 millions dont 9 millions de chats et 8 millions de chiens) comme a augmenté le nombre des foyers qui en possèdent (53 %). Ce qui a changé aussi, c’est le statut culturel des animaux de compagnie : ils font partie de la famille et même du « kit du bonheur parfait » de la famille moyenne, avec la maison individuelle et le jardin; rien n’est trop beau ni trop cher pour eux (dans le budget moyen des ménages, la part des animaux de compagnie est égale à la part des transports en commun, avion et bateau compris); ils sont de plus en plus anthropomorphisés, c’est-à-dire perçus et traités comme des humains, parfois même comme des substituts d’enfant ou de conjoint.
Le modèle dominant de l’animal de compagnie tend en outre à englober d’autres animaux, en particulier le cheval (j’y reviendrai dans un instant) et même la faune sauvage, sur laquelle se multiplient les documentaires animaliers montrant loups, ours, grands félins ou requins sous le traits de paisibles et inoffensives créatures, que l’homme, diabolisé, ne cesserait de persécuter sans raison...
3. La montée en visibilité de la mouvance animalitaire
Le monde de la protection animale est une nébuleuse complexe, qui comprend quelque 300 associations, qui vont de la SPA, fondée au milieu du XIXe siècle, aux « Amis du tourteau ».
Le changement tient, ici, à trois phénomènes conjoints :
1 - Un glissement progressif s’est opéré de la notion de « protection animale » conçue comme un devoir de l’homme, à la notion de ?« droits de l’animal » et même, pour les militants les plus radicaux, de libération animale au nom de l’« antispécisme » (mot calqué sur celui d’antiracisme pour les humains, par une analogie absurde puisque les espèces animales existent alors que les races humaines n’existent pas).
2 - La cause animalitaire est activement défendue auprès des autorités nationales et internationales par un lobbying à l’anglo-saxonne extrêmement puissant, ainsi, sur le terrain, que par des groupuscules radicaux hyperactifs, parfois très violents, au point d’être classés, aux États-Unis, comme la deuxième menace terroriste après l’activisme islamiste.
3 - Les idées protectionnistes rencontrent d’autant moins de résistance qu’elles se développent au sein d’une population majoritairement urbaine, coupée de ses racines rurales depuis plusieurs générations et qui n’a donc plus la moindre idée de ce que sont l’élevage et les animaux. Faute de résistance à qui viendrait l’idée de militer pour les mauvais traitements aux animaux ?, l’idéologie animalitaire s’est peu à peu érigée en une sorte de « politiquement correct », non d’ailleurs sans contradictions entre une opinion publique plutôt bienveillante envers les animaux et le comportement des consommateurs qui ne se montrent nullement prêts à payer plus cher des produits d’animaux élevés autrement. L’astuce stratégique du lobby animalitaire consiste donc à s’auto-proclamer porte-parole d’une majorité silencieuse... qui ne dément pas puisqu’elle est silencieuse et qu’au fond, rien de tout cela n’entre dans ses préoccupations prioritaires que sont le pouvoir d’achat, l’emploi, le logement et la santé.
Il n’existe d’ailleurs et j’insiste sur ce point aucune preuve de l’existence d’une « demande sociale » d’amélioration du sort des animaux d’élevage; cette prétendue « demande sociale » animalitaire n’est qu’une fiction, entièrement construite par les mouvements protectionnistes eux-mêmes, à partir de bribes d’opinions, souvent contradictoires, glanées ici et là, sélectionnées selon des critères philosophiques et éthiques par définition , et qui relèvent de la croyance et de l’émotion beaucoup plus que du raisonnement rationnel.
La préoccupation du « bien-être animal » (traduction controversée de l’anglais welfare), dont on nous rebat les oreilles et dans laquelle il faudrait voir la saine expression d’un?« juste milieu », n’est elle-même issue d’aucune « demande sociale », mais résulte :
1 - de la pression exercée, au niveau de l’Union européenne, par les lobbies anglo-saxons, dans le cadre d’une guerre commerciale entre agricultures du Nord et agricultures du Sud, pour affaiblir ces dernières en leur imposant des normes plus contraignantes de traitement des animaux aussi bien que sanitaires (pasteurisation des produits laitiers) ou linguistiques (hégémonie de l’anglais);
2 - de la reprise à leur compte de la notion de bien-être animal par les directions d’institutions scientifiques comme l’INRA dans un but de « communication », pour contrecarrer les accusations de productivisme contre-nature qui sont portées contre elles (voir Jean-Paul Bourdon, « Recherche agronomique et bien-être des animaux d’élevage. Histoire d’une ?demande sociale », Histoire et Sociétés Rurales, n° 19, 2003, p. 221-239).
Or le concept de bien-être animal est gravement entaché d’anthropomorphisme (certains militants parlent même du « bonheur » des animaux), il échappe à toute définition scientifique et est donc instrumentalisable à des fins militantes. Si ce « bien-être » correspond à un bon état de santé des animaux, la notion n’est pas nouvelle : les éleveurs parlent depuis déjà fort longtemps d’animaux « en état » et aucun d’eux (à l’exception de quelques brebis galeuses comme il y en a partout, ou de professionnels en très grande détresse) ne serait assez stupide pour mettre sur le marché des animaux pas en « état » qu’il risquerait de mal ou de ne pas pouvoir vendre ! Si c’est plus ou autre chose, qu’est-ce que c’est ? Comment pourrait-on savoir en quoi consiste le ?« bien-être animal » alors que les spécialistes de la santé humaine eux-mêmes ont renoncé à savoir ce qu’est le bien-être humain et qu’eux-mêmes ne parlent jamais que de ?« bien-traitance » (des enfants, des vieillards, des malades dans les structures d’accueil correspondantes) ? Cette notion de bien-traitance, qui fait référence à l’action exercée, est en effet infiniment préférable à celle de bien-être, qui se rapporte aux effets, difficiles à appréhender, présumés produits par cette action. Dans ce contexte d’incertitude, ?il faut une bonne dose d’inconscience voire de cynisme pour oser rechercher, par exemple en vue de labels de qualité viande, des critères de « bien-être » du bétail européen (critères de satiété, de temps de sommeil, etc.) qui sont inconnus d’une grande partie de l’humanité...
En réalité, l’injonction du bien-être animal dissimule un piège : sous des apparences de modération, de « juste milieu » se cache une redoutable logique de toujours plus, source d’une inévitable dérive extrémiste et anti-humaniste, qui pousse la revendication de « bien-être animal » à se muer (comme on le vit aux Rencontres « Animal et Société » du printemps 2008) en exigence de reconnaissance par le Code civil d’un statut particulier d’« être sensible » intermédiaire entre les personnes et les biens (avec les conséquences juridiques et économiques que l’on imagine), puis en revendication de « droits de l’animal » (voir la ?« Déclaration universelle des droits de l’animal » de 1978, obscène parodie de la Déclaration des droits de l’homme). La même dérive entraîne les végétariens (opposés à la consommation de viande) à devenir végétaliens (opposés à la consommation de tout produit animal) puis véganiens (opposés à toute utilisation et élevage d’animaux). Elle conduit, enfin, l’antispécisme à mettre en accusation et à diaboliser l’homme, et à se transformer ainsi en anti-humanisme, en?« spécisme » anti-humain...
Prochain article « La place particulière du cheval dans ce paysage général »
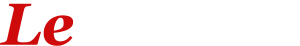
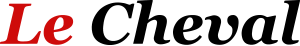
 Open Amateur
Open Amateur Culture
Culture Filière
Filière Juridique
Juridique






























Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous