Détendez-vous, LISEZ !
(en ligne le 04 avril 2009) Allez, juste avant (ou juste après) le concours, prenez le temps de vous détendre en lisant. En lisant d'abord cette chronique de Jean-Louis Gouraud et ensuite les bouquins de ses copains. C'est du lourd et terriblement bien ficelé. ERJ’ai
des amis épatants. Des gens formidables : intelligents, doués, beaux (parfois). Parmi eux, beaucoup d’écrivains. Non, je ne m’en plains pas, mais cela présente de temps en temps quelques inconvénients. Lorsqu’ils se mettent tous à publier en même temps, c’est alors un peu comme dans ces dîners en ville insupportables, où se mènent simultanément trente-six conversations : on ne sait plus où donner des oreilles. Avec leurs livres, c’est pareil. On ne sait pas par lequel commencer. À défaut d’une meilleure idée, j’ai suivi cette fois l’ordre alphabétique.
Jean-Louis ANDRÉANI
(et Honoré de BALZAC)
Après avoir collaboré pendant vingt ans au « Monde », l’illustre quotidien du soir, au sein duquel il a réussi à maintenir, vaille qui vaille, et contre une rédaction-en-chef qui jugeait la chose trop frivole, un vague suivi de l’actualité équestre, Jean-Louis Andréani s’est lancé, l’innocent, dans l’édition de livres. Comme si le pari n’était pas encore assez risqué, il a décidé de s’y cantonner à la seule littérature régionale. Et encore ! Pas de toutes les régions, non, d’une seule – d’ailleurs menacée de disparition par le « Rapport Balladur » : la Picardie.
Pour rendre l’opération plus audacieuse encore, il a donné à sa petite maison un nom à coucher dehors, mais qui ne manque pas de charme, et indique bien où vont les sympathies : cela s’appelle les éditions du Trotteur ailé (sic). Dans une collection intitulée « Lettres de Picardie », il y publie à un rythme effréné (deux titres tous les deux mois) des chefs d’œuvre oubliés, des textes anciens, des romans d’autrefois ayant tous pour décor l’Aisne, l’Oise ou la Somme. Après nous avoir ainsi fait découvrir un Alexandre Dumas enfoui dans l’amnésie générale, voici qu’il nous propose un Balzac inconnu. Une œuvre de jeunesse, Wann-Chlore. « C’est l’œuvre d’un déjà très grand romancier », insiste Andréani, qui adore les métaphores hippiques : « comme si Balzac, âgé d’à peine 26 ans, avait essayé, dans ce galop d’essai déjà magnifique, toutes les nuances de sa future palette ».
Wann-Chlore raconte l’histoire d’un homme partagé entre deux femmes sublimes, deux « anges » (ailés eux aussi). Pour ajouter au bonheur de son nouvel éditeur, le héros du roman est cavalier et les chevaux y caracolent en tous sens.
Sylvie BRUNEL
Cela a fait et va faire grincer quelques dents, mais c’est ainsi : le roman de Sylvie Brunel Cavalcades et dérobades, paru voici peu chez Lattès, vient d’obtenir le Prix Pégase, le Renaudot du cheval ou, pour répéter un gag dont je ne suis pas peu fier, le Goncourt hippique (ah ! ah !). Décerné en coopération avec l’Ecole Nationale d’Equitation et le Cadre Noir de Saumur, ce prix devrait être réservé, proclament certains puristes (tu parles !) aux traités d’équitation savante, aux spécialistes de l’épaule en dedans, aux arrières petits-neveux du général L’Hotte. Pas à une femme libre pratiquant une équitation joyeuse, même si celle-ci montre à toutes les pages, avec modestie (et talent), qu’elle est à la recherche permanente de la vérité équestre. Pardon, mais je préfère voir honorée une de ces « nouvelles cavalières » (l’expression est de Jean-Pierre Digard) pratiquant une « équitation sentimentale » (l’expression est de Antoinette Delylle) au culte idolâtre d’un écuyer qui ordonna que ses chevaux soient abattus après sa mort, afin que nul ne puisse les monter après lui.
Le choix de récompenser Sylvie Brunel est d’autant plus judicieux que cette dernière, tout en étant très représentative de la population cavalière d’aujourd’hui, en offre un excellent contre-exemple, en ne sombrant pas dans les dérives chevalitaires de la plupart de ses semblables.
C’est grâce à des femmes comme elle que le cheval ne sera pas plus cantonné aux rectangles de dressage ou aux hippodromes qu’aux parcs zoologiques ou aux réserves soi-disant naturelles.
La Nature, la vraie, Sylvie Brunel connaît. C’est son truc. Professeur de géographie (à la Sorbonne), spécialiste du développement durable (sujet auquel elle a consacré un « Que sais-je » et, tout récemment, chez Larousse, un formidable petit essai pétulant, A qui profite le développement durable), elle vient de publier, chez Larousse encore, un gros livre savant mais accessible à tous (on aimerait que les gros livres savants d’équitation, dont semblent raffoler ceux qui critiquent le choix du jury Pégase cette année, le soient autant) sur un sujet qui concerne, cette fois, non pas le petit million de privilégiés qui, en France, montent à cheval, mais près d’un milliard d’affamés dans le monde. Intitulé Nourrir le monde (et sous-titré vaincre la faim), ce bouquin aux allures de livre scolaire pose les bonnes questions – et tente d’y apporter les bonnes réponses : la planète va-t-elle cesser de pouvoir alimenter tous ceux qui l’habitent ?
Philippe DEBLAISE
En voilà encore un dont l’hyperactivité laisse pantois. Un de ces personnages multiples à propos desquels on s’interroge : mais comment fait-il donc ?
Comment s’y prend-il pour mener ainsi de front trois ou quatre métiers ? Où en trouve-t-il le temps, l’énergie, l’enthousiasme ? Philippe Deblaise produit du cognac. Philippe Deblaise élève des chevaux (arabes). Philippe Deblaise fait pousser des bonsaïs (japonais). Philippe Deblaise a créé la plus grande librairie au monde de livres rares ou anciens consacrés au cheval, à l’équitation, à l’hippologie (« Philippica », qui n’a pas vraiment pignon sur rue, mais édite régulièrement un catalogue dans lequel on a envie de tout acheter. On peut aussi aller y voir sur internet : www.philippica.net). Philippe Deblaise est consulté par des collectionneurs ; il réalise des expertises pour des commissaires-priseurs ; on le voit dans les salons du livre, les brocantes, les foires aux chevaux, les déballages de vieux papiers. Et tout cela ne suffit pas à remplir ses journées, dont chacune, de toute évidence, dépasse largement les 35 heures ! Car en plus, il écrit des livres ! Des petits essais pointus, comme celui qu’il a consacré, en 2002, à l’Itinéraire du livre équestre dans l’Europe de la Renaissance (de Rusius à La Broue) ou comme sa toute récente biographie de Charles Perrier, libraire parisien au seizième siècle. Et aussi des romans.
Des romans qui sont parfois des chefs d’œuvre, comme Gaspard des chevaux, publié aux éditions du Rocher (collection « cheval-chevaux ») qui obtint, lui aussi, un Prix Pégase (2005) sans que, cette fois là, personne ne trouve à y redire.
Un deuxième puis un troisième roman ont suivi de peu, et voici que, tirant une nouvelle salve, Philippe Deblaise en publie deux autres, presque coup sur coup. Le premier est un récit d’aventure : Le manuscrit de Pignatelli, édité également au Rocher (mais hors collection) raconte les tribulations à travers l’Europe du XVIe siècle d’un ouvrage inédit dont l’auteur n’est autre que l’illustre écuyer napolitain. Deblaise y décrit, en particulier, de façon saisissante, la fameuse tuerie de la Saint-Barthélemy, au cours de laquelle, à Paris, furent massacrés près de trois mille protestants… et pillée l’imprimerie qui s’apprêtait à publier le précieux manuscrit, dont on ne connaîtra donc jamais le contenu.
Philippe Deblaise a l’art de mêler ainsi la grande et les petites histoires, d’entrelacer des épisodes tirés de son imagination fertile à des faits ou des décors réels. Il le prouve une fois encore dans l’étrange petit roman qu’il vient de publier chez Le Croît vif (un nom d’éditeur presque aussi farfelu que Le Trotteur ailé de Jean-Louis Andréani). Dans cette espèce de « polar » un peu intello (mais pas trop) dans lequel les femmes ont des prénoms masculins, Deblaise raconte comment un écrivain, se glissant dans la peau de son homonyme, met le doigt dans un engrenage qui finira par le broyer. Le titre : Au sommet des grands pins.
Christophe DONNER
À une époque où la politique n’est plus qu’une sorte de pantalonnade, où présidents, premiers (et derniers) ministres ressemblent de plus en plus à leurs marionnettes des Guignols de l’info, il était temps que quelqu’un nous explique enfin qu’il faut, au contraire, prendre tout cela très au sérieux. Au moins autant, en tout cas, qu’une course de chevaux. C’est dire.
Voilà d’ailleurs pourquoi Christophe Donner, assistant au dernier congrès du Parti Socialiste, prend des paris, comme il le fait habituellement à Vincennes, Auteuil, Longchamp ou Chantilly. Après avoir étudié de près le comportement de chacun des candidats en lice, suivi au jour le jour leur entraînement, réfléchi aux diverses combinaisons possibles, il mise, le bougre, 20'000 euros sur Sego.
C’est une catastrophe, mais en même temps ça fait un bon titre : celui du dernier petit livre (formidable) de Christophe Donner (chez Grasset).
Une catastrophe, parce que c’est Martine Aubry qui rafle la mise. « Trucage ! » s’écrie alors Donner, dans l’indifférence générale – preuve qu’on n’est pas vraiment ici sur un hippodrome, mais bel et bien dans un politodrome. « S’il y avait eu des paris officiels sur cette course, déclare-t-il, un vrai pari mutuel à la française, ça ne se serait pas terminé comme ça, les associations de parieurs se seraient révoltées contre le déroulement de l’épreuve, ils auraient fait appel de la décision des commissaires, on aurait au moins annulé la course. »
Oui mais voilà, non seulement on n’est pas sur un hippodrome, mais on n’est pas non plus dans la réalité : on est dans la littérature.
Dans cette petite fable moderne, cette « sotie » comme il dit, Donner nous prouve une fois encore – ce qu’on savait déjà depuis L’influence de l’argent sur les histoires d’amour, paru chez Grasset en 2004 – qu’il est aussi bon sur les courtes distances que sur les longues. C’est un bon, un très bon cheval. Juste une récrimination : quelque part, il écrit (ou fait dire à son narrateur) « trêve de grands mots, je n’ai jamais réussi à décrire bien » une course. Trêve de modestie plutôt, mon cher Christophe ! Ton chapitre six est un morceau d’anthologie : il fait le meilleur récit qu’on ait jamais écrit d’une course, elle aussi d’anthologie, il est vrai, l’Arc de Triomphe, qui vit l’époustouflante victoire de Zarkava. Meilleure pouliche, c’est sûr, que Ségolène…
Jérôme GARCIN
Il y a bien longtemps qu’il en est persuadé. Jérôme Garcin pense que la meilleure façon de bien connaître un écrivain n’est pas de lire son œuvre, en tout cas pas seulement, mais de le rencontrer, d’aller chez lui, de le voir dans son intimité, « dans son jus ». C’est ainsi que, d’une pierre deux coups, Jérôme Garcin a fait du pays, découvrant la Suisse pour rendre visite à Jacques Chessex ou la Bourgogne pour bavarder avec Jules Roy ou Claude Lévi-Strauss. Ces pérégrinations géographiques et littéraires, ces déambulations qui, toutefois, ne doivent rien au hasard, avaient déjà donné naissance, en 1995, à un très bon livre, Littérature vagabonde (Flammarion) dans lequel on trouve les portraits sensibles – ô combien ! – d’une pléiade très œcuménique, incluant Julien Gracq et Michel Tournier, René Char et Françoise Sagan, Patrick Modiano et François Nourissier, et, comme à l’Académie française, une quarantaine d’autres immortels, parmi lesquels François-Régis Bastide, auquel Garcin consacrera plus tard (2008) un livre-hommage entier, Son Excellence, monsieur mon ami (Gallimard).
Quinze ou vingt ans plus tard, Jérôme Garcin récidive avec une galerie de portraits, un panthéon au fronton duquel il est dit que Les livres ont un visage (Mercure de France). Avec son élégance habituelle, son talent de narrateur, sa finesse de psychologue, sa culture – immense – de grand lecteur, Garcin y fait vivre sous nos yeux, dans leur décor, une trentaine d’écrivains dont, à nouveau Gracq, Chessex, Nourissier, mais surtout beaucoup de nouvelles têtes, pas toujours célèbres – du moins, pas encore.
Jérôme Garcin en profite pour voir et nous faire voir du pays : l’Angleterre (de Julian Barnes), l’Allemagne (de Gabrielle Wittkop). Et ce voyage, comme il le dit, « par mots et par vaux », se termine, selon ma formule chérie, « par monts et par chevaux » : les trois derniers portraits du livre, en effet, sont consacrés à trois écrivains cavaliers : Homeric, Christine de Rivoyre et Patrice Franchet d’Espérey.
Jean GREGOR
Ceci est un message personnel. Il s’adresse à Jean Gregor, « jeune » écrivain, auteur déjà d’une bonne demi-douzaine de romans, qui me pose un gros problème. Voici ce message.
Mon cher Jean. Tu sais toute l’amitié et toute l’estime que je te porte. Je te l’ai dit, je l’ai écrit : on va finir un jour, c’est sûr, par s’apercevoir que tu es un écrivain, un vrai, un grand. Un jour, tu auras le Goncourt, le Nobel, la Légion d’Honneur, l’Académie française, je ne sais pas, quelque chose qui prouvera qu’on a enfin compris que tu es un auteur important, c’est-à-dire un créateur d’univers, un univers qui n’appartient qu’à toi mais que tu offres à tous. Tes contes « philéens », tes romans fantastiques (Turbulences, Frigo, Jeunes cadres sans tête), dans lesquels les hommes ressemblent à des machines et les machines à des hommes, n’ont pas été appréciés à leur juste valeur par la critique. Il semble que, cette fois, elle ait honoré ton nouveau roman, Zénith (Mercure de France) de sa bienveillante attention. Tant mieux. Bravo. Content pour toi.
Toutefois, je te demanderai, à l’avenir, de faire un petit effort. J’ai lu, bien sûr, Zénith. J’y ai admiré ton art de raconter de façon extraordinaire des histoires ordinaires, qui se mêlent et s’entremêlent sans jamais nous embrouiller la tête. Mais comment veux-tu que je parle de ce roman dans la presse équestre, seule dans laquelle paraissent mes chroniques ? Zénith est le roman d’une montre, d’accord, mais tu aurais pu, pour m’aider, utiliser cette montre, par exemple, pour chronométrer une course, ou pour voir si c’est l’heure de donner le picotin aux chevaux. Mais non, rien ! Le mot cheval n’apparaît qu’une seule fois. Pour dire que la maison du mec dont tu supposes qu’il fut le propriétaire de ta foutue montre a été remplacée « par une petite clinique vétérinaire pour les chevaux » (page 78). Je suis sûr que tu as écrit ça pour me faire plaisir, mais c’est n’importe quoi ! Pourquoi veux-tu qu’il y ait une clinique pour chevaux en plein cœur d’une ville industrielle ? Et si tel était le cas, la clinique ne pourrait pas être petite : les chevaux, mon cher Grego, sont des grosses bêtes ! Amitié. Jean-Louis Gouraud
Jean-Louis ANDRÉANI
(et Honoré de BALZAC)
Après avoir collaboré pendant vingt ans au « Monde », l’illustre quotidien du soir, au sein duquel il a réussi à maintenir, vaille qui vaille, et contre une rédaction-en-chef qui jugeait la chose trop frivole, un vague suivi de l’actualité équestre, Jean-Louis Andréani s’est lancé, l’innocent, dans l’édition de livres. Comme si le pari n’était pas encore assez risqué, il a décidé de s’y cantonner à la seule littérature régionale. Et encore ! Pas de toutes les régions, non, d’une seule – d’ailleurs menacée de disparition par le « Rapport Balladur » : la Picardie.
Pour rendre l’opération plus audacieuse encore, il a donné à sa petite maison un nom à coucher dehors, mais qui ne manque pas de charme, et indique bien où vont les sympathies : cela s’appelle les éditions du Trotteur ailé (sic). Dans une collection intitulée « Lettres de Picardie », il y publie à un rythme effréné (deux titres tous les deux mois) des chefs d’œuvre oubliés, des textes anciens, des romans d’autrefois ayant tous pour décor l’Aisne, l’Oise ou la Somme. Après nous avoir ainsi fait découvrir un Alexandre Dumas enfoui dans l’amnésie générale, voici qu’il nous propose un Balzac inconnu. Une œuvre de jeunesse, Wann-Chlore. « C’est l’œuvre d’un déjà très grand romancier », insiste Andréani, qui adore les métaphores hippiques : « comme si Balzac, âgé d’à peine 26 ans, avait essayé, dans ce galop d’essai déjà magnifique, toutes les nuances de sa future palette ».
Wann-Chlore raconte l’histoire d’un homme partagé entre deux femmes sublimes, deux « anges » (ailés eux aussi). Pour ajouter au bonheur de son nouvel éditeur, le héros du roman est cavalier et les chevaux y caracolent en tous sens.
Sylvie BRUNEL
Cela a fait et va faire grincer quelques dents, mais c’est ainsi : le roman de Sylvie Brunel Cavalcades et dérobades, paru voici peu chez Lattès, vient d’obtenir le Prix Pégase, le Renaudot du cheval ou, pour répéter un gag dont je ne suis pas peu fier, le Goncourt hippique (ah ! ah !). Décerné en coopération avec l’Ecole Nationale d’Equitation et le Cadre Noir de Saumur, ce prix devrait être réservé, proclament certains puristes (tu parles !) aux traités d’équitation savante, aux spécialistes de l’épaule en dedans, aux arrières petits-neveux du général L’Hotte. Pas à une femme libre pratiquant une équitation joyeuse, même si celle-ci montre à toutes les pages, avec modestie (et talent), qu’elle est à la recherche permanente de la vérité équestre. Pardon, mais je préfère voir honorée une de ces « nouvelles cavalières » (l’expression est de Jean-Pierre Digard) pratiquant une « équitation sentimentale » (l’expression est de Antoinette Delylle) au culte idolâtre d’un écuyer qui ordonna que ses chevaux soient abattus après sa mort, afin que nul ne puisse les monter après lui.
Le choix de récompenser Sylvie Brunel est d’autant plus judicieux que cette dernière, tout en étant très représentative de la population cavalière d’aujourd’hui, en offre un excellent contre-exemple, en ne sombrant pas dans les dérives chevalitaires de la plupart de ses semblables.
C’est grâce à des femmes comme elle que le cheval ne sera pas plus cantonné aux rectangles de dressage ou aux hippodromes qu’aux parcs zoologiques ou aux réserves soi-disant naturelles.
La Nature, la vraie, Sylvie Brunel connaît. C’est son truc. Professeur de géographie (à la Sorbonne), spécialiste du développement durable (sujet auquel elle a consacré un « Que sais-je » et, tout récemment, chez Larousse, un formidable petit essai pétulant, A qui profite le développement durable), elle vient de publier, chez Larousse encore, un gros livre savant mais accessible à tous (on aimerait que les gros livres savants d’équitation, dont semblent raffoler ceux qui critiquent le choix du jury Pégase cette année, le soient autant) sur un sujet qui concerne, cette fois, non pas le petit million de privilégiés qui, en France, montent à cheval, mais près d’un milliard d’affamés dans le monde. Intitulé Nourrir le monde (et sous-titré vaincre la faim), ce bouquin aux allures de livre scolaire pose les bonnes questions – et tente d’y apporter les bonnes réponses : la planète va-t-elle cesser de pouvoir alimenter tous ceux qui l’habitent ?
Philippe DEBLAISE
En voilà encore un dont l’hyperactivité laisse pantois. Un de ces personnages multiples à propos desquels on s’interroge : mais comment fait-il donc ?
Comment s’y prend-il pour mener ainsi de front trois ou quatre métiers ? Où en trouve-t-il le temps, l’énergie, l’enthousiasme ? Philippe Deblaise produit du cognac. Philippe Deblaise élève des chevaux (arabes). Philippe Deblaise fait pousser des bonsaïs (japonais). Philippe Deblaise a créé la plus grande librairie au monde de livres rares ou anciens consacrés au cheval, à l’équitation, à l’hippologie (« Philippica », qui n’a pas vraiment pignon sur rue, mais édite régulièrement un catalogue dans lequel on a envie de tout acheter. On peut aussi aller y voir sur internet : www.philippica.net). Philippe Deblaise est consulté par des collectionneurs ; il réalise des expertises pour des commissaires-priseurs ; on le voit dans les salons du livre, les brocantes, les foires aux chevaux, les déballages de vieux papiers. Et tout cela ne suffit pas à remplir ses journées, dont chacune, de toute évidence, dépasse largement les 35 heures ! Car en plus, il écrit des livres ! Des petits essais pointus, comme celui qu’il a consacré, en 2002, à l’Itinéraire du livre équestre dans l’Europe de la Renaissance (de Rusius à La Broue) ou comme sa toute récente biographie de Charles Perrier, libraire parisien au seizième siècle. Et aussi des romans.
Des romans qui sont parfois des chefs d’œuvre, comme Gaspard des chevaux, publié aux éditions du Rocher (collection « cheval-chevaux ») qui obtint, lui aussi, un Prix Pégase (2005) sans que, cette fois là, personne ne trouve à y redire.
Un deuxième puis un troisième roman ont suivi de peu, et voici que, tirant une nouvelle salve, Philippe Deblaise en publie deux autres, presque coup sur coup. Le premier est un récit d’aventure : Le manuscrit de Pignatelli, édité également au Rocher (mais hors collection) raconte les tribulations à travers l’Europe du XVIe siècle d’un ouvrage inédit dont l’auteur n’est autre que l’illustre écuyer napolitain. Deblaise y décrit, en particulier, de façon saisissante, la fameuse tuerie de la Saint-Barthélemy, au cours de laquelle, à Paris, furent massacrés près de trois mille protestants… et pillée l’imprimerie qui s’apprêtait à publier le précieux manuscrit, dont on ne connaîtra donc jamais le contenu.
Philippe Deblaise a l’art de mêler ainsi la grande et les petites histoires, d’entrelacer des épisodes tirés de son imagination fertile à des faits ou des décors réels. Il le prouve une fois encore dans l’étrange petit roman qu’il vient de publier chez Le Croît vif (un nom d’éditeur presque aussi farfelu que Le Trotteur ailé de Jean-Louis Andréani). Dans cette espèce de « polar » un peu intello (mais pas trop) dans lequel les femmes ont des prénoms masculins, Deblaise raconte comment un écrivain, se glissant dans la peau de son homonyme, met le doigt dans un engrenage qui finira par le broyer. Le titre : Au sommet des grands pins.
Christophe DONNER
À une époque où la politique n’est plus qu’une sorte de pantalonnade, où présidents, premiers (et derniers) ministres ressemblent de plus en plus à leurs marionnettes des Guignols de l’info, il était temps que quelqu’un nous explique enfin qu’il faut, au contraire, prendre tout cela très au sérieux. Au moins autant, en tout cas, qu’une course de chevaux. C’est dire.
Voilà d’ailleurs pourquoi Christophe Donner, assistant au dernier congrès du Parti Socialiste, prend des paris, comme il le fait habituellement à Vincennes, Auteuil, Longchamp ou Chantilly. Après avoir étudié de près le comportement de chacun des candidats en lice, suivi au jour le jour leur entraînement, réfléchi aux diverses combinaisons possibles, il mise, le bougre, 20'000 euros sur Sego.
C’est une catastrophe, mais en même temps ça fait un bon titre : celui du dernier petit livre (formidable) de Christophe Donner (chez Grasset).
Une catastrophe, parce que c’est Martine Aubry qui rafle la mise. « Trucage ! » s’écrie alors Donner, dans l’indifférence générale – preuve qu’on n’est pas vraiment ici sur un hippodrome, mais bel et bien dans un politodrome. « S’il y avait eu des paris officiels sur cette course, déclare-t-il, un vrai pari mutuel à la française, ça ne se serait pas terminé comme ça, les associations de parieurs se seraient révoltées contre le déroulement de l’épreuve, ils auraient fait appel de la décision des commissaires, on aurait au moins annulé la course. »
Oui mais voilà, non seulement on n’est pas sur un hippodrome, mais on n’est pas non plus dans la réalité : on est dans la littérature.
Dans cette petite fable moderne, cette « sotie » comme il dit, Donner nous prouve une fois encore – ce qu’on savait déjà depuis L’influence de l’argent sur les histoires d’amour, paru chez Grasset en 2004 – qu’il est aussi bon sur les courtes distances que sur les longues. C’est un bon, un très bon cheval. Juste une récrimination : quelque part, il écrit (ou fait dire à son narrateur) « trêve de grands mots, je n’ai jamais réussi à décrire bien » une course. Trêve de modestie plutôt, mon cher Christophe ! Ton chapitre six est un morceau d’anthologie : il fait le meilleur récit qu’on ait jamais écrit d’une course, elle aussi d’anthologie, il est vrai, l’Arc de Triomphe, qui vit l’époustouflante victoire de Zarkava. Meilleure pouliche, c’est sûr, que Ségolène…
Jérôme GARCIN
Il y a bien longtemps qu’il en est persuadé. Jérôme Garcin pense que la meilleure façon de bien connaître un écrivain n’est pas de lire son œuvre, en tout cas pas seulement, mais de le rencontrer, d’aller chez lui, de le voir dans son intimité, « dans son jus ». C’est ainsi que, d’une pierre deux coups, Jérôme Garcin a fait du pays, découvrant la Suisse pour rendre visite à Jacques Chessex ou la Bourgogne pour bavarder avec Jules Roy ou Claude Lévi-Strauss. Ces pérégrinations géographiques et littéraires, ces déambulations qui, toutefois, ne doivent rien au hasard, avaient déjà donné naissance, en 1995, à un très bon livre, Littérature vagabonde (Flammarion) dans lequel on trouve les portraits sensibles – ô combien ! – d’une pléiade très œcuménique, incluant Julien Gracq et Michel Tournier, René Char et Françoise Sagan, Patrick Modiano et François Nourissier, et, comme à l’Académie française, une quarantaine d’autres immortels, parmi lesquels François-Régis Bastide, auquel Garcin consacrera plus tard (2008) un livre-hommage entier, Son Excellence, monsieur mon ami (Gallimard).
Quinze ou vingt ans plus tard, Jérôme Garcin récidive avec une galerie de portraits, un panthéon au fronton duquel il est dit que Les livres ont un visage (Mercure de France). Avec son élégance habituelle, son talent de narrateur, sa finesse de psychologue, sa culture – immense – de grand lecteur, Garcin y fait vivre sous nos yeux, dans leur décor, une trentaine d’écrivains dont, à nouveau Gracq, Chessex, Nourissier, mais surtout beaucoup de nouvelles têtes, pas toujours célèbres – du moins, pas encore.
Jérôme Garcin en profite pour voir et nous faire voir du pays : l’Angleterre (de Julian Barnes), l’Allemagne (de Gabrielle Wittkop). Et ce voyage, comme il le dit, « par mots et par vaux », se termine, selon ma formule chérie, « par monts et par chevaux » : les trois derniers portraits du livre, en effet, sont consacrés à trois écrivains cavaliers : Homeric, Christine de Rivoyre et Patrice Franchet d’Espérey.
Jean GREGOR
Ceci est un message personnel. Il s’adresse à Jean Gregor, « jeune » écrivain, auteur déjà d’une bonne demi-douzaine de romans, qui me pose un gros problème. Voici ce message.
Mon cher Jean. Tu sais toute l’amitié et toute l’estime que je te porte. Je te l’ai dit, je l’ai écrit : on va finir un jour, c’est sûr, par s’apercevoir que tu es un écrivain, un vrai, un grand. Un jour, tu auras le Goncourt, le Nobel, la Légion d’Honneur, l’Académie française, je ne sais pas, quelque chose qui prouvera qu’on a enfin compris que tu es un auteur important, c’est-à-dire un créateur d’univers, un univers qui n’appartient qu’à toi mais que tu offres à tous. Tes contes « philéens », tes romans fantastiques (Turbulences, Frigo, Jeunes cadres sans tête), dans lesquels les hommes ressemblent à des machines et les machines à des hommes, n’ont pas été appréciés à leur juste valeur par la critique. Il semble que, cette fois, elle ait honoré ton nouveau roman, Zénith (Mercure de France) de sa bienveillante attention. Tant mieux. Bravo. Content pour toi.
Toutefois, je te demanderai, à l’avenir, de faire un petit effort. J’ai lu, bien sûr, Zénith. J’y ai admiré ton art de raconter de façon extraordinaire des histoires ordinaires, qui se mêlent et s’entremêlent sans jamais nous embrouiller la tête. Mais comment veux-tu que je parle de ce roman dans la presse équestre, seule dans laquelle paraissent mes chroniques ? Zénith est le roman d’une montre, d’accord, mais tu aurais pu, pour m’aider, utiliser cette montre, par exemple, pour chronométrer une course, ou pour voir si c’est l’heure de donner le picotin aux chevaux. Mais non, rien ! Le mot cheval n’apparaît qu’une seule fois. Pour dire que la maison du mec dont tu supposes qu’il fut le propriétaire de ta foutue montre a été remplacée « par une petite clinique vétérinaire pour les chevaux » (page 78). Je suis sûr que tu as écrit ça pour me faire plaisir, mais c’est n’importe quoi ! Pourquoi veux-tu qu’il y ait une clinique pour chevaux en plein cœur d’une ville industrielle ? Et si tel était le cas, la clinique ne pourrait pas être petite : les chevaux, mon cher Grego, sont des grosses bêtes ! Amitié. Jean-Louis Gouraud
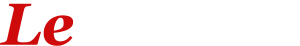
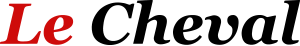
 Open Amateur
Open Amateur Culture
Culture Filière
Filière Juridique
Juridique


















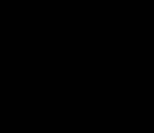











Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous