Gaspard Koenig à cheval sur les traces de Montaigne
En apprenant que j’écris ces chroniques pour Le Point, certains de mes hôtes me présentent comme journaliste. Pour ne pas embrouiller davantage des situations déjà complexes, je me garde de les détromper, même si je ne possède aucune carte de presse. Je me pose moi-même la question : suis-je philosophe parce que j’en ai les diplômes, écrivain parce que j’écris des livres ou journaliste parce que je rapporte ce que je vois ? Alors que j’aborde l’ultime tronçon de mon chemin vers Rome, sur cette via Francigena qui y mène tout droit depuis des siècles, il est peut-être temps que je donne une définition sinon de moi-même, du moins de mon travail.
Étymologiquement, il suffit pour être journaliste de tenir un journal, à commencer par un journal personnel. C’est ainsi que Montaigne louait son père d’écrire, ou plutôt de faire écrire, « un papier journal pour insérer tous les faits notables et, jour par jour, les mémoires de l’histoire de sa maison […]. Usage ancien que je trouve bon à rafraîchir, chacun dans sa chacunière. » Montaigne fut fidèle à cette méthode en faisant rédiger son journal de voyage par un serviteur, avant de reprendre la plume lui-même à partir de son arrivée à Rome. Ne trouvant nullement déshonorant de noter l’état de la literie ou les incidents survenus dans les auberges, Montaigne fait du journalisme afin que, plus tard, dans le calme de sa tour, l’écrivain prenne le relais, transformant la matière première en pensée ouvragée. À moins que les Essais ne soient à leur tour que le journalisme de soi-même, la gazette du moi errant. « Mon métier et mon art, c’est vivre, écrit Montaigne. Je m’étale entier : c’est un skeletos. »
Assumer le singulier. Ce qui caractérise ce journalisme-là, c’est moins la recherche de l’objectivité, débat sans fin et sans grand intérêt, qu’une liberté pleine et entière dans la démarche même du journaliste. L’objet de la recherche compte moins que la recherche elle-même, digne d’être narrée. Le regard singulier prend le pas sur le fait brut, à condition d’être assumé comme tel. Durant mon voyage, je me suis arrêté comme Montaigne une semaine à Plombières-les-Bains, charmante station thermale figée dans la Belle Époque, où une musique mélancolique résonne le long des façades décrépies, et où l’on s’attend à tout moment à voir surgir Napoléon III de retour d’exil. Je voulais y prendre les eaux, mais le virus m’en a empêché : le privilège d’une séance de balnéo était réservé aux vrais curistes, « tarif Sécu » ; faute d’ordonnance, je me suis contenté de la visite des thermes romains, sauna souterrain dont on ressort ému et trempé.
Durant une conférence improvisée au cinéma de la ville, un aimable érudit m’a suggéré de lire Albert Londres. Sur ses conseils, je me suis plongé durant quelques jours dans le bagne de Cayenne, les bordels parisiens et les asiles de fous des années 1930. Dans chacune de ces enquêtes, le sujet évolue en cours d’écriture : à Cayenne, le journaliste s’aperçoit que le pire bagne est hors les murs ; à Pigalle, que la traite des Blanches passe par Buenos Aires ; au contact des médecins, que les plus fous ne sont pas ceux que l’on croit. De telles bifurcations n’auraient jamais pu se produire si Albert Londres ne disposait pas du défraiement le plus précieux : le temps. Le temps de musarder, de se tromper, de revenir sur ses pas, de penser à autre chose. On a beaucoup dépeint Albert Londres en journaliste « engagé », comme si l’écriture était une conscription ; mais s’il donne son opinion, c’est moins pour exprimer un avis que pour livrer ses propres sentiments, doutes et états d’âme à la sagacité du lecteur. Il devient l’objet de son reportage.
Esclaves des news. En ce sens, je me sens pleinement journaliste. Ma curiosité se nourrit des occasions que le hasard m’offre. J’ai découvert la tétée des veaux et la récolte des olives, les chasseurs à courre et les néoruraux, les ingénieurs bavarois et les marquises florentines. Sur la route, j’ai bavardé avec les terrassiers des campagnes, les gamins des banlieues et les édiles des grandes villes. J’ai écouté les chants des vêpres dans une abbaye et j’ai déballé le tapis de prière d’une mosquée. J’ai observé aussi bien le comportement des automobilistes que la composition des petits déjeuners, avec toutes leurs variantes régionales. J’ai recueilli des avis tranchés sur la gestion des forêts, la doctrine du pape François ou l’avenir du grand tétras. Autant de sujets inattendus dont j’observe les méandres comme ces sentiers à peine visibles dans la forêt, en espérant retrouver un jour mon chemin principal, celui de l’humanisme européen.
En essayant d’être journaliste, je comprends mieux ce que le journalisme ne doit pas être : une autoroute, où des informations passent à toute vitesse sans détour, sans odeur ni saveur. A-t-on vraiment besoin de suivre les « nouvelles » ? Depuis le 22 juin, je me suis sevré de toute presse quotidienne, de tout site d’info et, cela va sans dire, de toute interaction sur les réseaux sociaux. On vit très bien, et même beaucoup mieux, sans connaître la dernière déclaration de Donald Trump, la polémique parisienne du jour ou le comptage des décès du Covid. Je ne suis pas indifférent au monde : je m’immerge dans mon environnement immédiat, celui dans lequel je peux agir. Au repos quelques jours près de Montalcino, je prends des « nouvelles », tous les matins, de deux chats roux à qui je sers une tasse de lait : voilà mon actu.
Pauvres journalistes esclaves des news, passant leur journée à commenter le fil de l’info derrière un écran. Happés par l’autoroute, ils ne peuvent plus changer de direction. J’ai le souvenir d’un article paru sur mon voyage dans la presse régionale où l’auteur me prêtait des propos confondants de naïveté sur le multiculturalisme. Ce qui est impardonnable, c’est moins d’inventer des citations que d’en produire d’aussi convenues, notre entretien ne servant qu’à valider un texte rédigé à l’avance. « Faire un sujet », pour un journaliste, sans pouvoir l’interrompre ni le modifier, c’est déjà passer à côté, comme « faire une ville » pour un touriste.
Il faut payer. À l’inverse, le journalisme véritable, le journalisme des sentiers, ne se conçoit pas sans carte blanche. Mais cette disponibilité a un coût, aussi bien moral – pour le journaliste, qui doit renoncer à ses idées préconçues – que financier – pour le journal qui lui fait confiance. Et ce coût doit être supporté par le lecteur. Pour obtenir une presse de qualité, qui ne soit pas inféodée au capital ou au clic, il faut payer. Or il s’est répandu cette idée néfaste que l’écrit devrait être gratuit. Plus de la moitié des messages reçus sur mon site me reprochent, avec plus ou moins de courtoisie, que mes chroniques soient réservées aux abonnés du Point en ligne. Une amie richissime m’a expliqué que, dans ces conditions, elle refusait de me lire. « Comment, mais je croyais que c’était du partage ! » Or l’abonnement au Point numérique coûte à peu près autant que de prendre un apéritif en terrasse ou de visiter un musée. Chacun comprend que le bistrotier, la boulangère ou le conservateur ne sont pas des rapaces obsédés par l’appât du gain et refusant le « partage », mais de modestes entrepreneurs cherchant à vivre de leur métier. Pourquoi en serait-il autrement de la presse ? Par qui devrait être payé l’investissement du Point et de moi-même dans ce périple, sinon par ceux qui, en bout de chaîne, apprécient de suivre ce dernier ? Réclamer la gratuité, c’est livrer la presse aux oligopoles de toute nature et mettre en danger la démocratie.
Mon journaliste modèle, ce serait ma jument, Destinada. Elle mémorise tout, n’a peur de rien, ne se moque de personne, et avance dans le monde avec curiosité, les oreilles dressées à la moindre nouveauté. Il faut seulement lui pardonner son obsession pour le broutage, qui l’empêche d’apprécier pleinement les paysages et les rencontres. Si elle devait écrire son journal de voyage, ce serait l’enquête la plus fouillée, la plus précise, la plus complète sur l’évolution des touffes d’herbe du Périgord au Latium. Desti rédac’ chef !
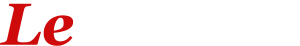
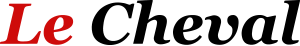
 Open Amateur
Open Amateur Culture
Culture Filière
Filière Juridique
Juridique































Vous devez être membre pour ajouter des commentaires. Devenez membre ou connectez-vous